
2016

L'USURE DES GÉOMÉTRIES
du 1er octobre au 10 décembre 2016
Christophe Verfaille est mort en 2011 à 58 ans. Il laisse une œuvre quasi méconnue qui ne fut exposée, de son vivant, qu'en de très rares occasions. Cette œuvre, dont l'apogée se situe dans les années 90 et début 2000, il l'a élaborée « debout et entêté » au cours d'une vie marquée par la précarité et la maladie. En 2003, il résumait ainsi sa proposition picturale : « Peindre à la glycéro, sur contreplaqué, l'emboîtage de structures de formes droites entamées par leur ponçage ». Cette « usure des géométries » – ce sont encore ses mots – produit l'effet d'une matière-couleur dense comme le gypse, d'une peau inimitable, irreproductible, qui magnifie les qualités chromatiques et a-compositionnelles de ses tableaux. « On a affaire à une matité insondable, à une profondeur que l'œil seul ne peut étreindre. (…) Mais à cette matité absorptive, Verfaille ajoute le lisse, c'est à dire la marque la plus immédiate du superficiel (au sens étymologique du terme). Dès lors il crée un objet inouï, il invente un tableau contradictoire – à la fois épais et mince, profond et plat, à la fois feuille de papier buvard et table de formica ». (Yve-Alain Bois in « Le lisse et le mat », 1996 ; texte repris et complété pour l'exposition de l'artiste à la Galerie Buchholz en 2013).
Nous remercions Bernard Joubert, Claire-Lise et Alain Barrier, ainsi que les amis de l'artiste
pour le prêt des tableaux présentés dans cette exposition.
L'œuvre de Christophe Verfaille est représentée par la Galerie Buchholz (Cologne, Berlin, New-York).
> lire la suite
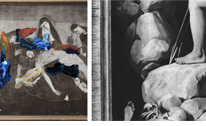
MUSÉE, MÊME
du 30 avril au 9 juillet 2016
Après l'exposition « Musée », qui présentait des œuvres d'Alain Sicard et de Bernard Guillot, nous associons à nouveau, sur le même thème, un peintre et un photographe : Bernard Joubert et Christian Milovanoff. De ce dernier sont montrées des photos de la série « Le Louvre revisité », un travail de 1985 dont la problématique fut ainsi résumée par Jean-François Chevrier (in Le Louvre revisité, éd. Contrejour, 1986) : « Christian Milovanoff aime la peinture, mais cet amour ne le porte pas à imiter… Si l'on pouvait réduire ses recherches à une trop simple équation, on pourrait dire : étant donnés le noir et le blanc (réduction, abstraction, etc.), une tradition picturale illusionniste – à laquelle s'est toujours rattaché l'essentiel de la création photographique – et une autre tradition, plus récente, qui privilégie au contraire l'étude formelle, l'expérimentation des caractères propres du médium, que peut aujourd'hui la photographie face à la peinture, ou plutôt, à côté de la peinture ? ».
Bernard Joubert, quant à lui, nous décrit ainsi son travail : « Les peintures présentées ont été réalisées sur des reproductions d'œuvres d'art de grands musées européens. Les supports sont des photographies, des gravures ou encore des chromolithographies, toujours choisis pour l'intérêt des images et des techniques de reproduction. Depuis 2012, mon travail sur ces images prend la forme de "peintures écrasées". Je réalise dans un premier temps un projet abstrait, qui pourrait aussi bien être peint sur une toile blanche. La disposition des touches retenue indépendamment du support est ensuite transposée sur la photographie ou la gravure. Enfin, le verre du cadre original est reposé sur l'ensemble, écrasant les touches de peinture à l'huile. Cadre, image, peinture forment alors un tout indissociable. » Sa manière à lui, peut-être, de répondre à la question qu'il est tentant de mettre en miroir de celle énoncée par Jean-François Chevrier : que peut aujourd'hui la peinture face à la photographie, ou plutôt, à côté de la photographie ? – À côté ? Bras dessous bras dessus en quelque sorte.
Christian Milovanoff est représenté par la Galerie Françoise Paviot
et Bernard Joubert par la Galerie Alain Coulange, à Paris.
> lire la suite

MUSÉE
du 23 janvier au 2 avril 2016
Mnémosyne eut neuf filles. Le Musée fut leur sanctuaire. C'est en ce lieu – mais aussi dans les livres d'art – qu'Alain Sicard puise inlassablement la matière première de son travail pictural. « J'ai, dit-il, l'obsession de la peinture et de toutes les images de la peinture…
Ma peinture est comme une généalogie désorganisée de l'histoire de l'art, je ne démarre rien, je ne fais que recevoir. » Dès lors, l'exposition à DIX291 de ses « aphorismes picturaux » prend, logiquement, un caractère muséal. Jusqu'à inclure, en guise de bonus,
un diaporama des centaines de photos – fragments, détails, distorsions – qu'il a prises dans les musées.
« Lorsque, à l'automne 2006, au hasard d'une promenade dans l'Île aux Musées posée sur la Spree,
à Berlin, je franchis le seuil du Bode-Museum, éblouisssant d'une blancheur irréelle, j'eus l'intuition d'être convié à franchir un autre seuil, celui de la Chambre des Mystères, celui des salles d'attente métaphysiques, celui de l'accès à l'Invisible. » C'est par ces mots que Bernard Guillot, peintre et photographe, nous présente la suite complète des photographies enregistrées au cours de sa déambulation initiatique dans le musée berlinois qui, à l'issue d'une longue restauration, venait de rouvrir ses salles au public : espaces vides de toute œuvre, seulement habités par les ombres spectrales de leurs visiteurs, présents… ou passés ?
Alain Sicard est représenté par la galerie Bernard Jordan et Bernard Guillot par la galerie Frédéric Moisan, à Paris.
> lire la suite